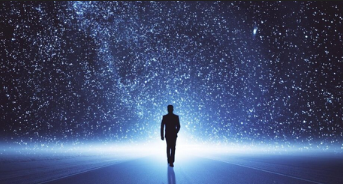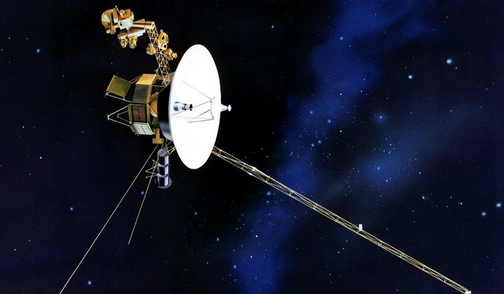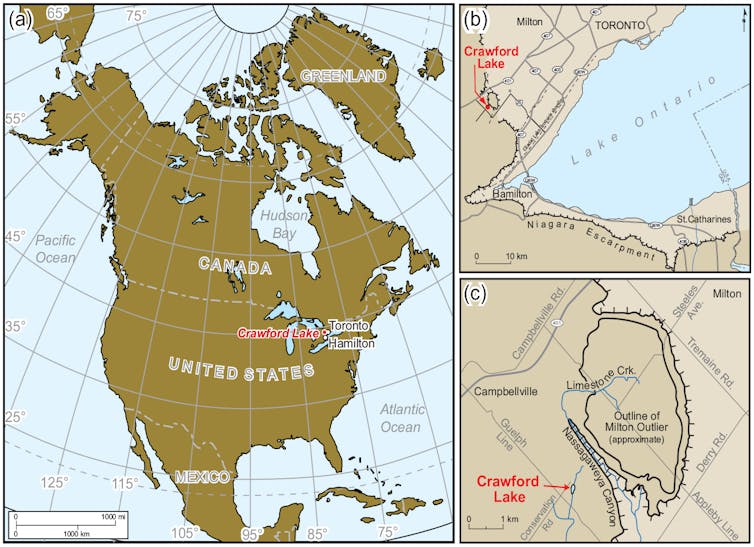Dans les fratries, les jeunes babouins de la réserve de Tsaobis (Namibie) semblent avoir des réactions de jalousie qui interpellent les scientifiques.
Les travaux sur les émotions ressenties par les animaux dévoilent une vie psychique riche et des liens sociaux qui vont jusqu’au deuil. Troisième volet de notre série d’été consacrée à l’intelligence animale.
(Cet article est extrait du dossier « L’intelligence animale se dévoile », paru initialement dans le n° 14 de la revue Carnets de science.)
On sait depuis longtemps que les larmes du crocodile n’ont rien à voir le chagrin, mais il n’est plus interdit de penser que certains poissons éprouvent de véritables peines de cœur. C’est en tout cas ce qu’affirme une équipe de biologistes du laboratoire Biogéosciences1, à Dijon, preuves à l’appui. Chloé Laubu, Philippe Louâpre et François-Xavier Dechaume-Montcharmont ont ainsi décrit récemment comment le cichlidé zébré, petit poisson bleuté d’Amérique centrale, en l’occurrence une femelle, perdait manifestement tout enthousiasme dès qu’on la séparait de son compagnon mâle, apportant la preuve expérimentale que les animaux éprouvent des émotions complexes.
Si chacun d’entre nous peut se convaincre tous les jours au contact de son chien ou de son chat que les animaux expérimentent la joie, la colère ou la tristesse, cette intuition reste très liée à notre vécu. Sujet complexe s’il en est, l’exploration des émotions animales reste en effet un défi pour la science, alors que les recherches ne cessent de s’intensifier depuis que l’éthique et la souffrance animales sont devenues des sujets de société.

Le cichlidé zébré femelle perd son optimisme lorsqu’on la sépare de son compagnon mâle : elle ne prend plus la peine de soulever le couvercle d’une boîte potentiellement remplie de friandises.
Ce sont d’ailleurs les protocoles initialement imaginés dans les années 1990 pour étudier le bien-être des animaux d’élevage qui ont rendu possible l’observation des émois amoureux du cichlidé zébré : en l’occurrence, le protocole du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, qui permet d’identifier les individus plutôt optimistes et ceux qui sont plutôt pessimistes. « On apprend aux poissons à ouvrir le couvercle de deux boîtes, l’une contenant une petite friandise et dotée d’un couvercle noir, l’autre vide et dotée d’un couvercle blanc, raconte Chloé Laubu. Ce n’est pas un geste habituel pour eux, l’exercice est fastidieux et suppose de leur part une vraie motivation. » On remplace ensuite les deux boîtes par une troisième, au couvercle gris, donc au contenu incertain. Les poissons qui tentent quand même leur chance sont déclarés optimistes, les autres pessimistes. On place alors des femelles à proximité de mâles pour qu’elles forment un couple stable avec l’un d’entre eux. Si on les prive ensuite de la présence de ce mâle, elles deviennent pessimistes dans le sens où elles renoncent à ouvrir le couvercle gris. Preuve, selon la chercheuse, que l’état émotionnel se modifie selon la présence ou l’absence de son partenaire.
Démonstrations d’empathieLes affinités entre individus sont donc bien réelles. Si la protection d’une mère pour son petit est un comportement communément admis dans le règne animal, les primatologues observent de longue date les liens qui se tissent ou non entre individus d’un même groupe. On sait aussi que les vaches préfèrent toujours paître avec les mêmes « copines » et que leur comportement se modifie si l’on modifie les groupes. Depuis le début des années 2000, on s’intéresse de manière plus expérimentale à ces liens d’attraction. Des expériences ont montré, par exemple, qu’ils s’exprimaient chez des oiseaux, les cailles notamment : placés au bout d’un tapis roulant à contresens, de jeunes cailleteaux déploient toute leur énergie pour rejoindre certains de leurs congénères, réunis à l’autre bout du local, lorsque d’autres les laissent totalement indifférents.

Biologiste du comportement, Alain Boissy travaille depuis plus de vingt ans sur les émotions des animaux d’élevage.
Au-delà des liens d’affinité ou de parenté, les scientifiques constatent qu’il existe aussi de véritables comportements d’empathie chez de nombreuses espèces. « Certains animaux se soucient de ce qui arrive aux autres et sont capables d’entraide, confirme Dalila Bovet, éthologue au laboratoire Éthologie, cognition, développement, à l’université Paris-Nanterre. Cela ne relève pas simplement de l’anecdote, ce sont des compétences avérées par des protocoles expérimentaux. » L’une d’entre elles joue sur la gourmandise des rats, grands amateurs de chocolat. Un premier rat peut accéder sans difficulté à sa friandise préférée, mais pas l’un de ses camarades, piégé dans un enclos très réduit. Au lieu de se précipiter sur le chocolat, le premier rat va d’abord délivrer son congénère, et cela sans même obtenir de récompense supplémentaire. Cela peut même se vérifier sans récompense à la clé : le premier rat cherchera à délivrer son compagnon avant de reprendre ses occupations.
Sens de la justice« Cet altruisme purement gratuit se manifeste même chez des animaux qui ne sont pas apparentés ou qui ne se rendront jamais la pareille. On peut aller dans certains cas jusqu’à parler d’un sens de la justice chez les animaux », poursuit la chercheuse, qui fait référence ici aux expériences du primatologue néerlandais Frans de Waal. Celui-ci a fait travailler deux chimpanzés, avec comme récompense des jetons donnant droit à du concombre. Mais lorsque le chercheur donne du raisin, meilleur que le concombre, à l’un des deux singes, l’autre refuse de travailler, sans doute saisi, selon certains chercheurs, par un sentiment d’injustice.
Une autre primatologue, Élise Huchard, du Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive2 de Montpellier, s’intéresse désormais à la jalousie, car elle est convaincue qu’il s’agit là d’une porte d’entrée pour mieux comprendre le vécu émotionnel des animaux. Au sein d’une population de babouins qu’elle suit depuis plus de vingt ans au cœur de la réserve de Tsaobis, en Namibie, elle tente de décrypter les réactions de jalousie parmi les fratries. « Lorsqu’une mère toilette l’un de ses petits, elle lui manifeste de l’attention et de l’affection, raconte la chercheuse. Or, il arrive que l’un de ses autres petits vienne interférer dans l’opération. Nous essayons de comprendre s’il fait cela simplement pour rediriger le toilettage vers lui ou plutôt pour perturber celui de son frère ou de sa sœur, en un mot pour nuire à la relation qu’il ou elle entretient avec sa mère, par jalousie. D’après ce que nous pouvons observer, c’est plutôt cette seconde hypothèse qui doit être retenue. »
Sentiments amoureux, jalousie, empathie… La recherche réussit à cerner chez l’animal des vécus plus complexes que de simples émotions de joie ou de tristesse. Les animaux sont des êtres sensibles, présents au monde comme de véritables sujets, même si en apporter la démonstration reste un vrai défi. « Comme dans le cerveau humain, on sait que les animaux vertébrés possèdent un système limbique, les structures neuronales qui gèrent les émotions et la mémoire, explique le neurobiologiste et philosophe Georges Chapouthier. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ont les mêmes vécus que nous, d’autant que notre système de perception est différent, voire très différent : comment repérer les émotions que ressent un animal face à une couleur ou une odeur que nous-mêmes ne percevons pas ? »
Un individu, une émotionAlain Boissy, biologiste du comportement des animaux, a ouvert une autre voie, davantage fondée sur la psychologie cognitive. À l’occasion de travaux réalisés pour le compte de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) sur le bien-être animal à partir des années 2000, il a été amené à évaluer le rôle de la cognition dans les réactions émotionnelles. « Des expériences en psychologie humaine ont montré, explique-t-il, que face à une situation donnée, tout individu traite l’information de façon quasi automatique et inconsciente pour évaluer s’il s’agit de quelque chose de nouveau, de soudain, d’agréable ou au contraire de désagréable, et s’il peut exercer un quelconque contrôle sur la situation. Ce processus d’évaluation permet de comprendre pourquoi deux individus, confrontés aux mêmes circonstances, ne ressentent pas nécessairement la même émotion ou la même intensité d’émotion. »
Lorsqu’il y a une accumulation d’émotions négatives à la suite d’une exposition à des événements désagréables, l’animal n’évalue plus son monde de la même manière. Ce biais systématique dans son jugement entretient un état d’humeur négatif qui persiste dans le temps.
Le chercheur a validé l’existence de ce processus chez des agneaux en modulant une caractéristique dans leur environnement : nouveau par rapport à familier, soudain par rapport à lent, prévisible contre imprévisible, contrôlable versus incontrôlable, etc. Ainsi, après avoir appris aux agneaux à appuyer sur un poussoir pour déclencher une distribution d’aliments d’une quantité donnée, le simple fait de diminuer par quatre cette récompense provoque un mouvement de retrait de la tête et un temps de latence avant que l’animal commence à manger. « Lorsque l’agneau est testé une seconde fois, il est moins enclin à appuyer sur le poussoir, contrairement à ses congénères qui continuent de recevoir la quantité initiale, raconte Alain Boissy. Ce qui indique que l’agneau agit sur le poussoir avec l’intention d’obtenir une quantité donnée d’aliments. Si la situation ne répond plus à ses attentes, il éprouve une émotion négative, inférée ici par la modification subtile de son comportement et des modifications transitoires de son activité cardiaque. »
Une vie psychique réelleDes signes comportementaux et physiologiques qui expriment une réelle vie psychique chez les animaux, au même titre que celle connue chez les humains. Sans chercher à plaquer notre propre lecture psychologique sur les réactions des animaux non humains, le biologiste constate que des réactions de peur de l’animal sont souvent liées à ce qu’il perçoit comme nouveau et soudain, de la frustration est ressentie quand la situation qui a changé ne satisfait plus ses propres attentes ou, inversement, de la joie si la situation répond au-delà de ses attentes.

Un zèbre essaie de « réveiller » une femelle gestante morte lors de la mise bas (parc d’Etosha, Namibie).
Dans quelle mesure l’émotion provoquée par un changement influence-t-elle alors la façon dont l’animal analyse la situation à laquelle il fait face ? C’est de cette question que sont nés les travaux entrepris sur les animaux inspirés du principe du verre à moitié vide ou à moitié plein évoqué plus haut. « On montre que lorsqu’il y a une accumulation d’émotions négatives à la suite d’une exposition à des événements désagréables, l’animal n’évalue plus son monde comme peut le faire un autre individu non soumis à ces expériences émotionnelles. Ce biais systématique dans son jugement entretient par inertie un état d’humeur négatif qui persiste malgré une amélioration éventuelle de son environnement », explique Alain Boissy.
Un état psychique qu’on peut alors qualifier de véritable souffrance animale, qui va bien au-delà de la simple douleur physique, et que les autres animaux du groupe sont d’ailleurs capables de percevoir. Les bovins, qui ont un bulbe olfactif très développé, ont la capacité de percevoir des substances odorantes déclenchées par le stress d’un individu, ce qui entraîne des réactions d’alerte dans le troupeau. Une vache pourra ainsi hésiter à entrer dans un enclos où l’une de ses congénères a souffert auparavant.
La question du deuilQuelle est l’intensité ou la profondeur de ces sentiments ? La question reste ouverte, mais depuis les années 2010, les chercheurs n’hésitent plus à l’aborder frontalement en s’interrogeant sur la question du deuil et sur les réactions des animaux face à la mort d’un proche. Une orque qui porte à la surface de l’eau son petit mort-né pendant dix-sept jours, une femelle chimpanzé qui semble vouloir ranimer le petit qu’elle vient de perdre… Les récits ne manquent pas, mais ont longtemps relevé de l’anecdote.
Les observations s’accumulent, qui donnent à penser que la mort d’un individu provoque de vraies manifestations de stress chez ceux dont il était proche.
Désormais, l’attitude de l’animal face à la mort est étudiée au sein de la thanatologie comparée. Élise Huchard, qui la documente dans le cadre de son projet de recherche sur les babouins, explique qu’il y a « une composante émotionnelle – on parle de deuil chez les humains –, mais aussi une composante cognitive, qu’étudie ma collègue Alecia Carter, en déployant des expériences simples sur le terrain, à savoir le concept de mort qu’ont les animaux. Celui-ci est complexe et implique, entre autres traits, que la mort ait une cause, qu’elle soit irréversible ou encore universelle, en un mot la conscience de la mort ».
Comme dans le cas de la jalousie, les deux chercheuses observent les comportements des babouins lorsque la mort d’un individu survient au sein du groupe. Elles constatent par exemple que si un petit encore accroché en continu au pelage de sa mère meurt, celle-ci le porte parfois avec un bras, parfois avec la bouche, pendant plusieurs jours, ce qui lui demande un réel effort et complique ses gestes habituels et les longs déplacements qu’elle doit faire pour se nourrir. La mère, parfois aussi le père, continue à protéger le petit cadavre des autres adultes et à le toiletter. De telles observations, encore parcellaires, s’accumulent pour différentes espèces et donnent à penser que la mort d’un individu provoque de vraies manifestations de stress chez ceux dont il était proche socialement. L’étude, effectuée sur le terrain, sera forcément de longue haleine, mais ses résultats pourraient dévoiler un peu plus, encore, toute la richesse de la vie psychique de l’animal. ♦
A lire sur le même thème :
De l’animal-machine à l’animal sujet
Etonnantes cultures animales
Source : lejournal.cnrs.fr